En complément à l’exposition «
Vodou, un art de vivre », qui se tient actuellement
au Musée d’ethnographie de Genève (MEG),
ce cycle de quatre soirées propose une sélection
de musiques et de danses afro-caraïbes, rituelles et
profanes. Deux d’entre elles seront consacrées
aux musiques haïtiennes : Ti-Coca et ses musiciens
présenteront un programme centré sur la poésie
chantée et la contredanse, expressions festives de
nature profane, mais enracinées dans le terreau du
vodou ; quant à Racine Mapou de Azor, il est aujourd’hui
l’ensemble emblématique de la musique et des
chants du vodou haïtien. Quant aux deux autres soirées,
elles sont dédiées à des expressions
proches de la tradition du vodou : la rumba et la musique
de la santería de Cuba, avec le groupe Yoruba Andabo
; puis la musique et les danses du gwoka de Guadeloupe,
représentées par l’ensemble Kan’nida
et son invité spécial le chanteur Napoléon
Magloire.
Laurent Aubert
Mercredi 20 février, 20h30
Cuba : Yoruba Andabo
Rumba, musique et danse afro-cubaines
|

Geovani
del Pino : direction
Juan Campos Cárdenas, Regla Monet Díaz,
Ronald González Cobas, Damian Díaz Leal,
Jorge Armando de Armas Sarría : chant
Orlando Lage Bouza, Julio César Lemoide Díaz,
Adonis Panter Calderón, Michel Herrera Pérez,
Derlys Zulueta Alfonso, Gilberto Williams Ramos :
percussions
Zulema Pedroso Hardy, Jenyset Lazara Galata Calvo,
Ramsés Charón Echevarría, Pedro
Lázaro Monteagudo Lara : danse
|
La santeria est à Cuba l'une des
nombreuses manifestations de la spiritualité de la
diaspora afro-caraïbe. Dans ces cultes ritualisés
faits de processions, de cérémonies secrètes,
de danses de possession, de sacrifices d'animaux et de magie,
les saints catholiques se confondent avec les orishas, divinités
africaines d'origine yoruba. Un syncrétisme qui pourrait
bien avoir été dû à la nécessité,
pour les esclaves, de donner à leurs croyances des
figures empruntées aux maîtres.
Fondé en 1961 dans le quartier du
port de La Havane, le groupe Yoruba Andabo est aujourd’hui
une des compagnies emblématiques de la musique et
de la danse afro-cubaines. Son vaste répertoire traverse
les cycles sacrés Congo Yoruba et Abakuá,
aussi bien que la rumba, avec ses trois formes constitutives
que sont le yambú, le guaguanco et la columbia. Sous
la direction de Geovani del Pino, cet ensemble de seize
musiciens et danseurs manie à la perfection les polyrythmies
cubaines : sur l’accompagnement des percussions traditionnelles
(tumbadora, cajón, guagua, chequeré, tambores
batá, clave…), les chants convient les divinités
à s’installer dans le corps des danseurs.
Jeudi 21 février,
20h30
Haïti : Ti-Coca et Wanga-Neges
L’art de la contredanse
|

Ti-Coca : voix, maracas
Allen Juste : accordéon
Mathieu Chertoute : tambours
Richard Hector : banjo
Wilfrid Bolane : contrebasse
Photo Michael Stewart
|
Ti-Coca, nommé ainsi en raison de
sa petite taille et de sa nature sautillante qui rappelle
l'incontournable breuvage, interprète ses meringues
suaves et épicées sur des mélodies
populaires inspirées du répertoire vaudou.
Héritier des meneurs de contredanses, Ti-Coca chante
les odes à Agoué, aux esprits de la mer, à
Erzulie ou a Simbi. Porté par l'accordéon,
le banjo, la basse et les percussions, son groupe Wanga-Neges
est un des rares ensembles haïtiens à avoir
conservé le caractère lancinant et chaloupé
de cette musique en petite formation acoustique.
Ti-Coca est une sorte de dandy tropical,
un personnage rare dans le paysage musical haïtien.
Par ses vocalises débridées, et son attachement
ludique aux formes anciennes, il tient à la fois
du chansonnier et du commandeur de contredanse. Quelque
part entre Haïti et Cuba, il y a dans sa musique un
retour à la danza cubaine, elle-même née
de la contredanse exportée de Saint-Domingue dans
la province de l'Oriente par les colons et quelques-uns
de leurs esclaves en fuite. Ces airs, que l'historien haïtien
Jean Fouchard nommait les « douces pastorales congo
», seraient, dit-on, issus des danses bantoues du
Mozambique.
Vendredi 22 février,
20h30
Guadeloupe : Ensemble Kan’nida,
avec Napoléon Magloire
Musique et danse rituelles du Gwoka
|
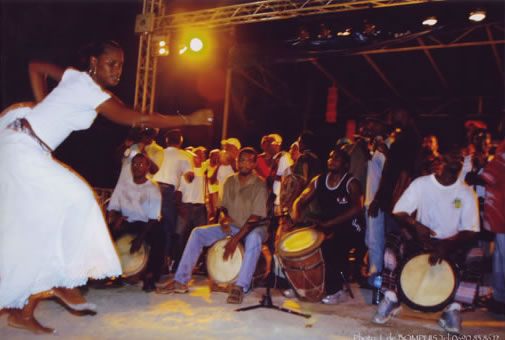
Fred Anastase : tambou maké
Jacques Danican : accordeon
Suzy Bondot Geneviève : répondè
Alain Caban : tambou boula
Vanessa Coco : dansè
Yannick Geoffroy : dansè
Nazaire Vincent : tambou boula
Anatole Geoffroy : chant solo
Christiane Geoffroy : calbas, dansè
René Geoffroy : tambou boula, chant solo, saxophone
Napoléon Magloire
: chant, invité spécial
Photo L. de Bompuis
|
Le gwoka, symbole essentiel de la culture
guadeloupéenne, était jadis joué par
les esclaves des plantations sur les tambours ka (du français
quart), fabriqués avec des barils. Son origine remonte
au début du XVIIIe siècle. A partir des musiques
de leurs pays d’origine, les esclaves ont élaboré
un outil de communication, un moyen d’expression,
au même titre que la langue créole. Cette musique
est encore jouée aujourd'hui lors des veillées
nommées swaré tanbou, avec percussions et
danses accompagnant des textes en créole. Nombre
de ses rythmes trouvent leur origine dans les codes tambourinés
qu'utilisaient jadis les esclaves.
Le groupe Kan’nida, originaire de
la commune de Sainte-Anne, en Guadeloupe, présente
l'expression musicale des Grands Fonds, région du
centre de la Grande-Terre où se développa,
après I'abolition de l'esclavage, une société
paysanne quasi autarcique, vivant dans les plantations de
canne à sucre. La musique de Kan’nida est l’héritière
des chants de labours et de veillée mortuaire qui
ont rythmé la vie de cette population depuis plus
de cent cinquante ans. Avec comme invité spécial
Napoléon Magloire, doyen des chanteurs de gwoka,
Kan’nida affirme sa volonté de transmettre
la mémoire de la Guadeloupe.
Samedi 23 février, 20h30
Haïti : Racine Mapou de Azor
Percussions et chants rituels du Vodou
| 
Lenord « Azor »
Fortuné : chant, tambour
Jérôme Siméon : tambour
Ronald Jean : tambour
Ludner Toussaint : tambour
François Fortune : tambour basse
Lemour Fortune : tambour basse
Elius Ozius : tambour basse
Ronine Faustin : chœur
Manicite Dure : chœur
Photo Dominique Lagnous
|
Autrefois confinée aux zones rurales
du pays, où elle était pratiquée par
des musiciens amateurs regroupés autour des temples
vaudou, la musique traditionnelle haïtienne est aujourd’hui
portée par le mouvement « rasin », qui
revendique les racines africaines de l’identité
haïtienne. Il n’aura guère fallu que quelques
années d’existence au groupe Racine Mapou de
Azor pour gagner son pari : préserver l’authenticité
des chants et des rythmes issus du répertoire vodou
tout en les faisant connaître du public le plus large.
Formé de musiciens tous vaudouisants pratiquants,
son nom fait directement référence à
l’univers vaudou, le mapou étant l’arbre
sacré réputé héberger les esprits.
L’ensemble est dirigé par
le chanteur et tambourineur Lenord « Azor »
Fortuné, qui a permis à la musique vaudou
de passer du hounfort (le temple) à la scène.
Figure incontournable de la culture haïtienne, Azor
a récemment été sacré «
trésor national vivant » par le Ministère
de la culture. Partisan d’une musique rasin sans concession,
il refuse arrangements modernes et instruments électriques.
Soutenue par le battement inlassable des tambours d’inspiration
rada, petro ou encore rara, sa voix puissante, au timbre
caractéristique des prêtres vodou, célèbre
les loas (esprits) vaudou, chante l’attachement aux
racines ou commente les événements de la vie
sociale en Haïti.
Dès 19h, spécialiés culinaires
antillaises (Réservation recommandée au 078
757 01 04)
Photos : Dominique Lagnous (Azor), Frédéric
Palladino, Michael Stewart (Ti-Coca) et d.r.
Remerciements : Saïd Assadi, Damien
François, Claire Hénaut, Emmanuelle Honorin,
Pascale Jaunay, Yasmina Tippenhauer, Alain Weber
Prix des places
: 30.- FS
Membres Ateliers, AMR & Amdathtra, Amis du Musée
d’ethnographie, chômeurs, AVS : 22.- FS
Etudiants, jeunes : 15.- FS
Enfants jusqu’à 12 ans, cartes 20 ans/20 francs:
10.- FS
Conférence : entrée libre
Passe général : 80.- FS (plein tarif) / 60.-
FS (membres…) / 45.- FS (étudiants…)
Location : Service Culturel
Migros, 7 rue du Prince, Genève (lu-ve, 10h-18h),
dès le 28 janvier
Réservations : uniquement sur le site www.adem.ch
Renseignements : tél.
022 919 04 94
Concerts organisés avec le soutien du Département
de la culture de la Ville de Genève, du Département
de l'instruction publique de l'Etat de Genève et
de la Direction du Développement et de la Coopération
DDC.
